“Réorganisation des pensées inconscientes sans connaissance consciente : deux cas accompagnés de résistance intellectualisée contre l’hypnose (Milton H. Erickson)”
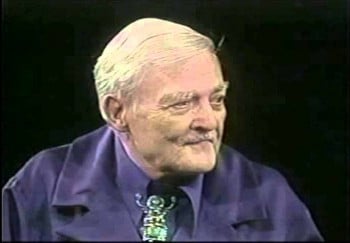 Un patient, âgé de quarante ans et souffrant d’une maladie respiratoire chronique de plus en plus handicapante, demanda à être traité par l’hypnose pour une consommation excessive et ancienne de cigarettes, allant de trois à quatre paquets par jour. D’après le patient, sa façon de fumer était de nature totalement compulsive, il lui était impossible de se contrôler, et il avait à plusieurs reprises essayé l’hypnothérapie sans résultat. Maintenant, et ce serait sa dernière tentative, il demandait encore une fois à être traité par l’hypnose comme « un ultime geste de désespoir ». Cette expression, expliqua-t-il, traduisait son absolue conviction que toute tentative d’hypnose échouerait.
Un patient, âgé de quarante ans et souffrant d’une maladie respiratoire chronique de plus en plus handicapante, demanda à être traité par l’hypnose pour une consommation excessive et ancienne de cigarettes, allant de trois à quatre paquets par jour. D’après le patient, sa façon de fumer était de nature totalement compulsive, il lui était impossible de se contrôler, et il avait à plusieurs reprises essayé l’hypnothérapie sans résultat. Maintenant, et ce serait sa dernière tentative, il demandait encore une fois à être traité par l’hypnose comme « un ultime geste de désespoir ». Cette expression, expliqua-t-il, traduisait son absolue conviction que toute tentative d’hypnose échouerait.
Induction de transe par des associations de truismes
Le thérapeute exprima silencieusement son accord au patient qui était assis en en observant le moindre mouvement avec une attention pathologique. Néanmoins, le patient exigea que l’auteur fasse une tentative d’hypnose, et il sembla à la fois soulagé et déçu de n’avoir aucune réaction hypnotique identifiable après une demi-heure d’induction méthodique de transe. Le patient exigea une autre tentative, mais il en fut dissuadé par le thérapeute qui suggéra ce qui suit :
- Le patient devait garder le regard fixé sur I ‘angle d’une horloge de bureau, « pour faire tenir ses yeux tranquilles ».
- II devait porter la plus grande attention au doux tic-tac de la pendule, « pour faire tenir ses oreilles tranquilles ».
- Les pensées décousues, les pensées ordonnées, les pensées systématisées devaient être libres de vagabonder dans sa tête sans entrave et spontanément, ou même de s’y attarder.
- À tout moment, le patient devait se sentir parfaitement éveillé, vigilant, et attentif à exécuter convenablement les tâches qu’on lui aurait attribuées ou que I ‘on allait lui attribuer. À la moindre ébauche de suggestion hypnotique ou de tentative pour induire une transe, le patient devait prêter toute son attention au thérapeute et interrompre de ce fait les tâches attribuées.
- Tout en prêtant attention au tic-tac de la pendule, il pourrait percevoir à sa guise les autres bruits dans le bureau, dans la pièce adjacente, hors du bureau, dans la rue, dans les airs.
- Il devait aussi avoir en permanence conscience de sa personne physique, son attention se déplaçant d’une partie du corps à I ‘autre, des pieds aux mains ou aux cuisses, puis au col autour de son cou, à ses cheveux sur la tête, puis recommencer en suivant toutes les variantes qu’il voudrait.
- À tout moment, le patient devait se sentir libre d’écouter consciemment tout ce que dirait le thérapeute, mais cela, lui expliqua-t-on, n’était pas vraiment nécessaire, puisque l’esprit inconscient constamment présent serait à portée de voix du thérapeute et pourrait écouter de lui-même tandis que I ‘ esprit conscient serait occupé avec la pendule, les pensées, les divers bruits, et tout ce qui pourrait l’intéresser, y compris les modifications dans la perception de son corps.
- A la fin de l’entretien, l’attention de ses yeux et de ses oreilles passerait doucement de la pendule au thérapeute.
Le patient fut très coopérant et obéit de façon excellente à ces instructions. En cinq minutes il présentait l’apparence d’un état de transe profonde. Pour vérifier cet état, au bout de dix minutes l’auteur fouilla laborieusement le bureau à la recherche d’un manuscrit, et ce faisant, il déplaça le pendule « sans faire attention » et la déroba à la vue du patient. Cela ne provoqua aucune réaction visible chez le patient dont le regard resta fixé sans bouger sur l’endroit où s’était trouvée la pendule. On put remarquer que ses pupilles étaient largement dilatées, comme on le constate souvent en hypnose profonde. Il ne parut pas non plus se rendre compte que le thérapeute quittait son siège et faisait quelques pas dans bureau ni avoir conscience du vacarme soudain d’un avion à réaction au-dessus du bureau.
La thérapie consista en une discussion prosaïque sur la nécessité physique pour le patient de cesser de fumer ; les mérites respectifs de la cigarette, de la santé physique, de se libérer des contraintes, et de la tranquillité d’esprit furent abordés sous divers angles.
Durant toute cette présentation, l’auteur rappela de temps à autre au patient de garder son attention visuelle et auditive fixées sur la pendule, de poursuivre toute sorte d’idée consciente qui pourrait l’intéresser, d’entendre et d’être attentif à ce qu’il souhaiterait, mais surtout de savoir que son activité consciente était de peu d’importance pour sa thérapie, et que la seule chose d’importance capitale était la réorganisation de ses pensées inconscientes qui se produisait sans qu’il en ait conscience.
En un mois, l’auteur rencontra six fois le patient et lui consacra onze heures en tout. À peu près la moitié de ce temps fut occupée à de vaines tentatives pour « m’hypnotiser », à la demande insistante du patient, et à parler amicalement de choses assez éloignées du problème à traiter. Le reste du temps fut consacré à la thérapie elle-même, telle qu’elle a été décrite pour l’essentiel ci-dessus. La thérapie se solda par une réduction à trois cigarettes après les repas et une juste avant le coucher.
Le mois suivant, le patient revint en suppliant que l’on supprime les cigarettes restantes, puisqu’elles étaient « les portes ouvertes au retour des vieilles habitudes ». Cette fois-là, il demanda à plusieurs reprises d’un ton hésitant que l’on recoure à l’hypnose mais, à chaque tentative, le patient se montra tout aussi résistant qu’à l’origine. Chaque fois l’auteur s’excusa, et le patient suggéra de recourir à la fixation de la pendule « parce que de cette façon j’écoute mieux».
L’ auteur utilisa la même séquence que précédemment avec une exception : le tabagisme, qui avait été excessif depuis la puberté, était maintenant un problème secondaire. La discussion porta sur les moments concernant les finances et les affaires de famille. Seize heures en tout sur une période de huit jours y furent consacrés, environ un quart de ce temps passé à bavarder dans le but d’obtenir des informations et de comprendre comment il voyait les choses. Le reste du temps, on procéda comme décrit ci-dessus, mais cette fois, en abordant les problèmes du moment autres que la cigarette, qu’il abandonna en cinq jours.
Au moment de terminer sa thérapie, le patient exprima ses regrets de n’être pas arrivé à développer un état de transe et s’étonna de ne pas pouvoir évaluer correctement l’écoulement du temps au cours des séances de thérapie. Il ne demanda aucune explication de ce fait, alors même que, au cours de ses discussions avec « l’esprit inconscient » du patient, l’auteur lui avait dit qu’il devait se sentir libre de demander des explications sur tout point qu’il ne comprendrait pas parfaitement.
Source : Manuscrit inédit 1956 du Dr Milton H Ericskon
Passionnant cet article qui démontre que l’hypnothérapie, bien au-delà des protocoles et des sentiers battus, nécessite des compétences approfondies en stratégie thérapeutique.
Vous avez sans doute repéré quelques stratégies déployées par Ericskon pour conduire cette séance :
- Stratégies d’induction
- Approche paradoxale pour décharger les résistances
- Focalisation
- Saturation sensorielle
- Hyper-conscience
- Confusion
- Stratégies thérapeutiques
- Distraction : prendre le temps et parler d’un tas d’autres choses pour dérouter l’attention du tabac vers d’autres aspects de la vie
- Désactiver le besoin de tabac et rendre la personne plus en accord avec sa vie
- Réorientations : recadrage coût /bénéfice de fumer…
- Progression solutionniste : avancer vers l’objectif plutôt que supprimer le problème

Merci pour cet article qui rappelle que l’attitude du thérapeute, sa centration sur l’intérêt du patient compte autant sinon plus que les techniques utilisées. Cela me rappelle aussi que la plainte du patient n’est pas toujours se qu’elle semble être.
[…] Un arrêt de tabac pour personne résistante […]